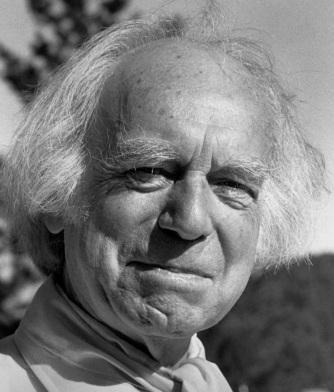Et si les héros des quêtes mythologiques et légendaires appartiennent toujours au sexe mâle, c’est aux femmes, en revanche, qu’est dévolue la mission d’impulser et de guider ces quêtes. De la merveilleuse pucelle jusqu’à la sorcière, car la femme est multiple et peut prendre tous les visages, ce sont elles qui animent l’homme, le mobilisent, lui insufflent l’énergie sacrée qui le pousse à agir. Et c’est encore elle, la femme, qui est la plupart du temps au terme de la quête. C’est en s’unissant à elle que l’homme acquiert le pouvoir qu’elle détient (car dans la tradition celtique, c’est la femme qui incarne le pouvoir et qui le délègue, pour qu’il l’exerce, à l’homme qui assure auprès d’elle sa fonction virile). Et c’est dans cette union aussi qu’il peut vivre, durant quelques instants, l’expérience du retour à la divinité initiale, avant-goût d’éternité puisque retour à l’état d’incréé qui ne s’inscrit pas encore dans le temps, but ultime de toute recherche spirituelle.