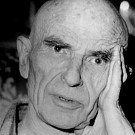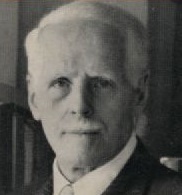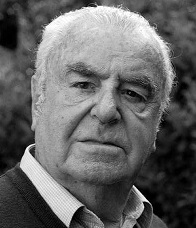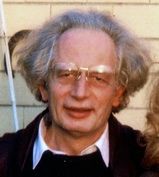Peu à peu dans les principales religions, en Égypte, en Syrie, en Mésopotamie, en Grèce, on vit émerger au-dessus de l’assemblée des Dieux-forces de la nature, puis des Dieux-incarnations d’attributs, un Dieu suprême, de qui tous les autres procédaient, et sur lesquels il régnait en monarque souverain. C’était le dieu solaire des Égyptiens et son char, le dieu lunaire masculin des Chaldéens qu’Abraham, après son père Terach, devait adorer à Ur, dans son enfance. Probablement à la même époque, tandis que le Mahabharata et la Ramayana résumaient les légendes mystiques des Indiens, les Brahmanes dont la sagesse allait étonner les conquérants Persans et Macédoniens, élevaient au-dessus de Brahma, Vishnou et Shiva, ces trois personnes de leur Trimourti…