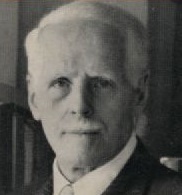L’Hindouisme nous a fourni un tableau typique des divers étages des conceptions que les hommes se forment de Dieu. Au-dessus des petits dieux naturistes agissant d’une manière caractérisée en un lieu déterminé, au-dessus des dieux totémiques également attachés à un territoire, mais étendant leur empire à toutes les formes vivantes, au-dessus du Dieu tribal qui, tout en ayant un autel de prédilection dans la capitale du peuple, est plus attaché à l’ensemble humain de celui-ci qu’à son espace vital ; l’Hindouisme place les dieux plus ou moins démiurgiques qui régissent l’ensemble de l’Univers solaire qu’ils ont créé. Ces dieux, dans leur essence, sont inhérents à toutes les créatures grâce à la pression de leur activité créatrice, protectrice et rénovatrice qui les maintient en vie…
Jacques de Marquette : Eschatologie ou perspectives finales