L’harmonisation des deux lobes est nécessaire et nous avons constaté le bienfait des asanas sur les problèmes découlant d’une mauvaise latéralisation voire d’une latéralisation contrariée par un système éducatif. Le but du yoga est d’élever l’être à des plans supérieurs en l’incitant à utiliser mieux son cerveau pour y développer la Conscience et la Liberté.
Catégorie : Thérapies & Approches Alternatives
Claude Le Prestre : La plus vieille médecine du monde : l'acupuncture
Qu’est-ce que l’acupuncture, cette thérapeutique qui, à près de quarante siècles d’écart, a gardé les mêmes pouvoirs étonnants? Si nous nous reportons à l’étymologie latine, (acus, pointe, et punctura, piqûre) cela veut dire piqûre par objet pointu. L’action d’employer des aiguilles pour obtenir la guérison d’un malade est d’origine chinoise et remonte à 5000 ans. Les Orientaux estiment, en, effet, que les maladies résultent du trouble de la force vitale, le K’i ou Énergie vitale, qui doit toujours être en équilibre entre deux forces opposées, le Yin et le Yang. Le diagnostic de la localisation et la nature de ce trouble sont révélés, à chaque poignet par la prise des pouls correspondant a un circuit déterminé de l’énergie vitale. La thérapeutique consiste à rétablir l’équilibre en enfonçant de fines aiguilles d’or (pour tonifier) et d’argent (pour calmer ou « disperser ») en des points cutanés spéciaux en rapport avec des fonctions organiques ou psychiques et avec l’énergie vitale, et répartis sur des lignes appelées méridiens ou kings.
André Mahé : Une médecine de la mécanique humaine : la vertébrothérapie
Et il ne s’agit pas d’une connaissance théorique et livresque acquise en consultant des planches et en assimilant une terminologie spéciale, ni même de celle qu’on croit posséder, pour avoir disséqué à l’amphithéâtre. Il s’agit de tout autre chose. Et, d’abord, de posséder instinctivement le sens du corps humain, de la mécanique humaine, dans sa statique et surtout dans sa dynamique. Sambucy a raison de distinguer à travers l’Histoire deux grandes lignées de thérapeutes, que l’on peut différencier non en gymnastes et conformistes, mais en biologistes et mécaniciens. De toute évidence, cette distinction correspond à deux types d’esprit, de sensibilité, de philosophie peut-être, encore que le mécanicien comprendra souvent les questions biologiques, tandis que le biologiste reste généralement fermé à toute véritable connaissance mécanicienne. Et depuis des siècles, la médecine occidentale a tourné le dos à ce qu’on appelle aujourd’hui la médecine physique, alors qu’elle était contenue dans l’enseignement hippocratique.
Dr Yves Davrou : La sophrologie, démarche profane vers la vole initiatique
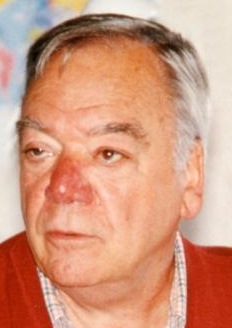
(Revue Question De. No 46. Février-Mars 1982) Il m’a toujours paru curieux de constater à quel point le silence entourait l’« initiation » à l’initiation. Certes, seul le vécu de chacun doit être à la base de l’initiation, mais encore faut-il avoir l’outil nécessaire. Le rituel est sensé, dit-on, être cet outil, mais combien de […]
Michel Carayon et Élisabeth de Saint-Basile : Comment appréhender la psychothérapie émotionnelle

Ce qui fait la richesse d’un travail de groupe, entre autres choses, c’est la possibilité de rencontrer des êtres humains dans une relation vraie. Nous découvrons que nous ne sommes pas les seuls à avoir des problèmes et qu’il n’est pas honteux de les exprimer. Le groupe est un moyen, non une fin, un instrument de travail qui permet de retrouver symboliquement et concrètement un passé (votre famille), le présent (vos relations difficiles avec votre entourage affectif et professionnel). Vous rejouez ici ce que vous avez fait ou ce que vous faites à l’extérieur ; vous le vivez, vous le sentez, vous l’exprimez pour vous en libérer, pour changer.
Micheline Flak : Le Yoga à l'école pour développer l'attention

Sous couvert de vitesse et de consommation passive les jeunes se sont laissés dépouiller du temps du rêve et de l’aptitude à inventer. Les enseignants ont beau faire : ils affrontent des enfants qui ne peuvent plus tenir en place et qui rappellent immanquablement l’image symbolique du singe ivre, évoquée dans les textes tibétains comme parangon du mental débridé. La sagesse traditionnelle, comme nous le verrons, a toujours insisté sur la nécessité de reconditionner l’attention avant de songer à restructurer les couches profondes de la personnalité.
Jacques Rauffet : Les remèdes floraux du docteur Edward Bach

Freud, certes, Jung surtout ou – mieux –, et les « entités viscérales » de la médecine chinoise nous ont familiarisés avec l’idée que nos troubles de santé tout physiologiques qu’ils soient, insomnie, asthme, ulcère d’estomac, etc., ont une cause réelle profonde non dans les seules agressions physiques, matérielles, volontaires ou non, qui assaillent notre organisme mais dans notre esprit, depuis l’énervement fortuit, mais violent, qui bloque la digestion d’un repas jusqu’au conflit « complexe » ancien et profond qui ravage notre mental conscient, en l’obsédant, ou notre inconscient, en y drainant le plus clair de nos énergies. E. Bach fera rendre à cette vérité un son d’une étonnante générosité illuminée par un authentique mysticisme : pour être bien portant, l’homme doit être heureux, ou plus exactement, ceci ayant pour effet cela, de « bonne » humeur, de cette humeur irradiante de Joie et pleine de notre appartenance, même par un fil ténu, au Divin. E. Bach déchiffrera un vieux secret alchimique : recouvrer, ou affermir, la santé par une modification subtile de nos « humeurs ».
Pierre Crépon : La magnétothérapie
En fait l’usage des aimants à des fins thérapeutiques remonte à l’Antiquité et une légende de la Grèce ancienne raconte que les propriétés curatives de l’aimant furent découvertes par un berger grec du nom de Magnès. Il semble d’ailleurs que la plupart des traditions anciennes, notamment chinoise, indienne, égyptienne, arabe, hébraïque, aient connu l’usage de l’aimant naturel qui pouvait, par exemple, être utilisé sous forme d’amulettes. Au cours des siècles de nombreux auteurs ont ainsi vanté les propriétés curatives de l’aimant et il nous suffit de citer ici les noms célèbres d’Aristote, de Pline, de Gallien, d’Avicenne, d’Albert le Grand ou de Paracelse. Au XVIIIe siècle, deux savants de la Société Royale de Médecine, Audry et Thouret, firent un rapport pour « vérifier l’efficacité de l’aimant dans le traitement des maladies », rapport dont la conclusion s’avère aujourd’hui prophétique : « L’aimant paraît devoir devenir un jour en médecine d’une utilité sinon aussi grande, du moins aussi réelle qu’il l’est maintenant en physique. » Pour la petite histoire, il est amusant de noter que c’est la même Société Royale de Médecine qui condamnait, quelques années plus tard, la théorie du magnétisme animal de Mesmer.
François Bruno : Le second visage d'Hippocrate : l'homéopathie
Les maladies ne sont pas des entités fixes et invariables qu’il suffit de nommer pour les caractériser. Chez chacun d’entre nous, elles prennent des formes particulières. Le médecin classique se contente de les identifier; il dit par exemple : « C’est une rougeole, ou une scarlatine. » L’homéopathe va plus loin : il doit déterminer la forme particulière que cette rougeole ou cette scarlatine prend chez un malade donné, et, pour cela, faire le recensement méticuleux de tous les symptômes propres à ce malade. Pourquoi procéder ainsi ? Souvenons-nous que le remède homéopathique est un « simillimum », un semblable. Autrement dit, il est d’autant plus efficace que les symptômes présentés par le patient auquel on l’administre sont plus proches des symptômes qu’il est lui-même capable de provoquer chez un sujet sain. « Le cas idéal, disait Hahnemann, est celui où la maladie artificielle créée par le médicament coïncide trait pour trait avec la maladie réelle que j’ai à traiter. » Dire aujourd’hui qu’il existe autant de maladies que de malades, c’est énoncer une vérité première qu’aucun médecin, quel qu’il soit, ne désavoue. Mais l’homéopathe est le seul à en tirer des conséquences pratiques et directement utilisables dans la thérapeutique. L’individualisation du malade, l’étude souvent fastidieuse de ses plus infimes réactions, de ses symptômes les plus ténus répondent, pour lui, à une nécessité impérieuse : il n’y a pas d’autres moyens d’orienter le choix du remède.
Jean Valnet : Résurrection de la médecine des simples : la phytothérapie et l'aromathérapie
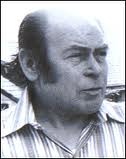
Pendant une période très longue de l’Histoire, les hommes n’avaient guère, pour se soigner, d’autres moyens que les plantes. De tous temps, ils se sont rendus dans les montagnes, dans les bois, dans les champs pour y trouver les végétaux, récolter les résines et les gommes. La simple observation, par quoi tout débute lorsqu’elle est au service d’hommes intelligents qui s’accordent le temps de méditer, a permis, voilà des millénaires, de dresser un bilan considérable des vertus offertes par les plantes dans la lutte contre la maladie, voire les épidémies…