Mais le paradoxe est tel que si la notion d’inconscient nous conduit à plus d’humilité et de finesse dans nos réflexions sur la communication, l’église psychiatrique semble avoir développé la qualité inverse : l’orgueil démesuré de vouloir rendre conscient tout et tout, comme si la reconnaissance du secret nécessaire devait conduire à la connaissance de ce secret ! Est-ce à dire que l’essai de comprendre l’inconnaissable est toujours entreprise luciférienne ? Est-ce à dire que toute science est prométhéenne ?
Étiquette : Inconscient
Rolande Biès : Le Mystère de la Conjonction
Le mariage entre le conscient et l’inconscient produit un choc qui ébranle, certes, mais qui entre en contact avec les ténèbres de la profondeur. Nous sommes alors non face à face (guerre, angoisse), mais reliés à nous-mêmes, car l’inconscient «n’est ni bon ni mauvais, mais bon et mauvais»; il est la mère de toutes les possibilités, et nous avons besoin de lui pour «embrasser toutes les parties du monde, toute l’étendue possible de la conscience». Il nous faudra donc, sans cesse, monter vers le ciel et descendre en enfer pour rencontrer notre centre/équilibre; c’est dans cet incessant mouvement que nous trouverons notre unité. L’émotion (le feu) purifiera et fera fondre nos opposés. Les étapes de ce processus sont des prises de conscience dues aux conflits qui mènent à la mort d’une partie de nous-même devenue inutile.
Gabriel Monod-Herzen : Transformer les oppositions en complémentarités
La solution du problème de l’opposition entre le corps et l’esprit, c’est de ne jamais oublier que la partie « vitale », la conscience la plus ordinaire, la plus simple, celle qui est directement en rapport avec notre sensibilité et même avec nos sentiments physiques, est le lien entre le supérieur et l’inférieur. Seulement cela vous obligera à faire attention à ce que vous faites ! Plus de laisser aller en espérant que cela se fasse tout seul ! Allez demander à une excellente cuisinière ou à un grand chef de cuisine comment on fait tel ou tel plat et demandez-lui s’il peut penser à autre chose qu’à ce qu’il fait ? Dès qu’il s’agira de doser une sauce, il va s’arranger pour mettre l’ingrédient dans la proportion voulue. Il ne va pas le peser, parce qu’il est parfaitement entraîné, mais il y aura un lien entre le supérieur et l’inférieur en lui qui va réaliser la chose qui est à faire.
Ysé Masquelier : Dialogue entre Jung et le yoga : à propos de la conscience et du symbole
« De quelle conscience parlons-nous en yoga ? Y a-t-il un champ commun entre lui et la psychologie jungienne ? ». Dans les deux cas, la conscience représente un fragment de la psyché, lié à l’existence d’un principe d’individuation (moi, ahamkara). Ce fragment ne trouve son sens et sa liberté qu’en fonction de son harmonie avec l’autre part (inconscient, samskara-vâsanâ). Jung pose ainsi le problème : qui suis-« je » dans ma totalité ? Que me manque-t-il, dont je ressens le besoin, pour m’accomplir dans mon intégralité ? Le yoga le poserait plutôt ainsi : De quoi dois-je me dépouiller pour recouvrer ma véritable identité ? De quels conditionnements dois-je délivrer l’âtman pour qu’il se dévoile et resplendisse ?
Alfred Herrmann : Nature et mécanismes du subconscient
L’action du conscient sur le subconscient consiste surtout à agir sur l’équilibre cellulaire. La plupart des maux dont l’homme peut être affligé se réduisent, en dernier lieu, à une question d’équilibre entre les cellules qui naissent et les cellules qui meurent ; de plus, il y a intervention de la question de naissance de cellules saines et dynamiques, de la mort et de l’évacuation de cellules malsaines, de l’évacuation normale de cellules mortes ainsi que de tous les déchets des cellules. Quoiqu’en pense la science officielle, tous les processus précités peuvent être influencés, non seulement par des facteurs matériels, mais encore par des facteurs psychiques ; nous dirons même que les facteurs psychiques l’emportent sur les facteurs matériels.
Alfred Herrmann : Le mystérieux subconscient
Maintes philosophies ou religions, se sont efforcées de définir les parties constitutives de la personne humaine. Ces tentatives et les dogmes qui en ont été déduits n’ont apporté que des résultats exagérément simplistes ; ou bien, en appliquant cette méthode, le problème n’a été résolu que d’un seul point de vue, souvent subjectif. La partition en un corps matériel et une âme immortelle, par exemple, est trop élémentaire. Les partitions effectuées par différentes théories spiritualistes d’origine chinoise, hindoue, arabe, les concepts chrétiens, théosophiques et j’en oublie, comprennent beaucoup d’aspects positifs mais n’envisagent jamais l’ensemble du problème.
Robert Linssen : Etudes psychologiques de C. G. Jung à J. Krishnamurti
Pour Krishnamurti et Jung, le conscient ne constitue qu’un infime fragment de notre « moi total ». Krishnamurti nous enseigne que la partie de nous-mêmes que nous connaissons avec une relative clarté ne constitue qu’une couche superficielle et fragmentaire de notre structure psychique. Celle-ci est extraordinairement complexe et se trouve formée de couches innombrables portant au plus profond d’elles-mêmes les mémoires obscures d’événements se perdant dans la nuit des temps.
Robert Linssen : Inconscient collectif et liberté spirituelle
La condition « sine-qua-non » de la découverte de la Vérité est l’affranchissement des conditionnements qui paralysent l’esprit. Parmi les conditionnements les plus lourds et les plus profonds se situent précisément ces créations de l’inconscient collectif exerçant sur l’âme humaine une emprise considérable.
Robert Linssen : Comment et pourquoi pensons-nous ? Qui pense ?
Les progrès de la psychologie nous ont permis de nous rendre compte de l’imprécision de nos réponses à la question la plus simple de toutes : « Que pensons-nous ? » Nous savons que la partie consciente de nous-mêmes — celle que nous connaissons avec une relative clarté — ne constitue qu’un infime fragment de notre moi total. Au delà de ce conscient périphérique et superficiel demeurent les séries de couches profondes formant l’inconscient. Cet inconscient est beaucoup plus important que le conscient. Son rôle est prédominant.
D.T. Suzuki : Causerie à Mexico
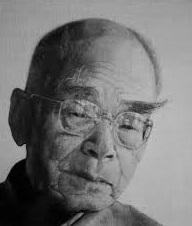
Il n’y a pas de processus progressif se réalisant pas à pas. Il y a une brusque rupture, un plongeon direct dans le vide. Nous devons dépasser l’intellect, déclara-t-il, en l’ayant utilisé au maximum de ses possibilités. L’intellect nous conduira au précipice, où nous devons sauter dans le vide.