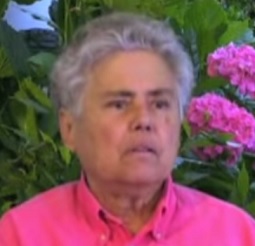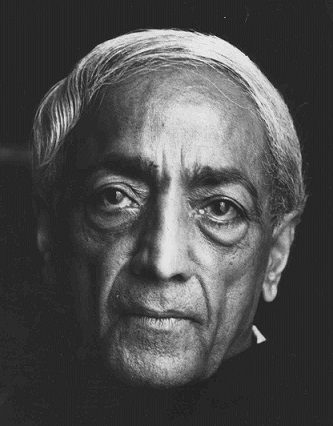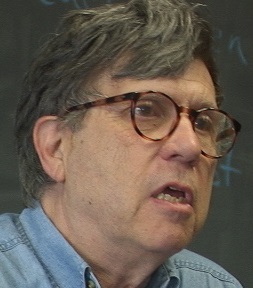XXX : Sur le chemin, carnet d'un chercheur
(Revue Être. No 1. 3e année. 1975) I Primauté de l’expérience pour l’individu engagé dans la recherche. Éclaircissement de la vision, mutation dans la saisie des choses. Se transformer : changer ce que l’on est : la petite mort. Bien peu y consentent. Ils préfèrent perfectionner leur esprit. Bricoleurs. Esthètes. Collectionneurs. Pensée qui ne sauve […]