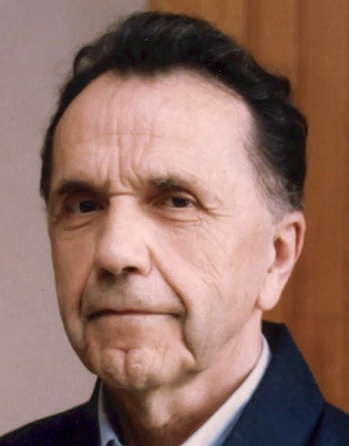LE CERVEAU CONSTRUIT L’IMAGE DE SOI Par le groupe d’étude pour la connaissance de l’homme « S’il est agréable de savoir comment le cerveau fonctionne, ce n’est absolument pas nécessaire pour faire l’expérience de quoi que ce soit » A.R. Damasio Face à la vérité universelle, l’approche scientifique contemporaine et l’approche spirituelle traditionnelle ne peuvent pas être […]
le groupe d’étude pour la connaissance de l’homme : Cerveau & Identification