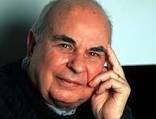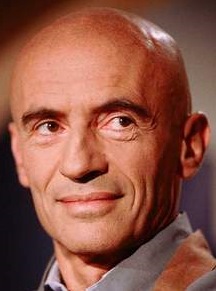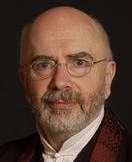Je détenais la preuve expérimentale de l’existence du corps de vacuité, du corps de jouissance, dénommé également corps glorieux ou corps subtil (dont la faculté psi, étudiée par les parapsychologues, est l’une des fonctions) et enfin du corps physique, de peau et de chair, de nerfs et d’os, sans compter ses milliards de neurones. Et j’avais l’impression que le second « travaillait » le troisième pour le rendre réceptif à l’énergie du premier. Je pouvais dès lors décoder la plupart des messages considérés comme ésotériques, véhiculés par les traditions spirituelles de l’humanité. Surtout, j’entrais inconsciemment dans le sentier du bodhisattva (Être éveillé, engagé à sauver tous les êtres), respirant largement au sein du cosmos car, comme dit le poète : « Le vent se lève, il faut tenter de vivre. »
Vincent Bardet : Comment le Zen est entré dans ma vie