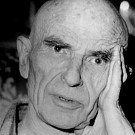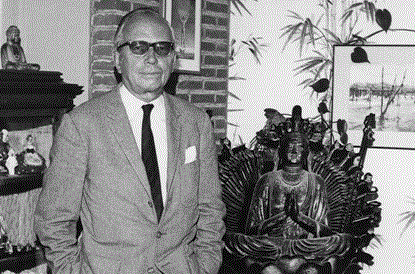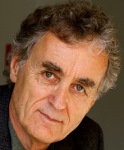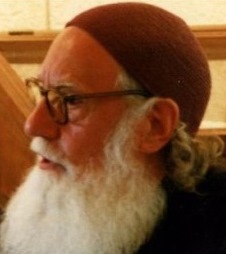L’appréhension par la vision d’une certaine forme donne naissance à des images qui vont être désignées chacune par un mot : sapin, chêne, bouleau, par exemple. Mais le concept d’arbre n’a aucune existence en dehors du mental qui l’a conçu. On ne peut voir, toucher, mesurer un arbre, mais seulement l’élément sensoriel, qui, avec d’autres similaires, a donné naissance au concept d’arbre. Enfin, de la même manière, l’intellect, à partir des concepts issus des premiers phénomènes sensoriels, en élabore d’autres de plus en plus généralisateurs. Après le concept d’arbre, on passe à celui de végétal, à côté de ceux de minéral, d’animal, de liquide ou de gaz. A un niveau d’abstraction encore plus grand, on arrive au concept d’être vivant, à l’opposé d’être inanimé et en dernier lieu, de généralisation en généralisation, on parvient au concept d’élément universel qui suivant les temps et les civilisations aura un vocable différent. En sens inverse, à partir de cette source commune, on reconstruit logiquement tous les systèmes métaphysiques et cosmogoniques.