De la préhistoire la plus reculée à nos jours, jamais, dans aucune culture, cette foi en la puissance musicale ne s’est affaiblie. Les chamanes sibériens battent toujours le tambour sur cadre et les Indiens entonnent leurs chants du peyotl. Partout, on fait de la musique. Pour élever l’âme, exalter les émotions, bercer, charmer, marcher, danser, travailler, rêver. Et chacun saisit intuitivement que ce pouvoir musical est le plus grand qui soit, le pouvoir même du verbe : le pouvoir de créer.
Catégorie : Auteurs A
Josette Brydelnevo : Les planètes de la violence
L’astrologie est un moyen, parmi d’autres, de déterminer le potentiel de violence qui existe chez chaque homme. Il convient tout d’abord de rappeler brièvement ses principes de base. Elle étudie les rapports qui existent entre les « symboles d’en haut », les planètes, et les « symboles d’en bas », les hommes ; les unes étant le reflet des autres. Son langage est symbolique et utilise des termes de correspondance et d’analogie. Le thème natal est le cliché exact de la position des astres dans le ciel au moment du premier « inspir ». Leur emplacement dans tel signe zodiacal, telle maison, leurs aspects (ou rapports angulaires entre planètes) indiqueront les possibilités dont dispose l’individu et qu’il sera amené à développer et à concrétiser sa vie durant. Ce cliché n’est pas statique. Les astres, continuant leur course dans le ciel, dynamiseront à chacun de leur passage (ou transit) tel point clef du thème, libérant ainsi l’énergie contenue en germe à la naissance.
La voie gnostique selon Abellio
L’illumination est comme le jeu de la lumière dans un cristal. La lumière jaillissante efface la structure du cristal, et c’est pourtant cette structure devenue invisible qui explique l’illumination. Mettre de l’ordre, c’est-à-dire dévoiler et fonder la structure absolue, c’est la loi de l’homme avancé d’Occident. Incarner ensuite cette structure et la fondre en soi, c’est la loi de l’homme tout court. Par le couronnement gnostique, foi et raison cessent alors d’être prises dans une opposition linéaire, elles sont dépassées et intégrées ensemble dans ce qu’il faut rien considérer comme la réalisation de l’être.
René Alleau : Inventaire des mystères et des principales sociétés secrètes depuis l'antiquité jusqu'aux temps modernes

Le culte des astres et des constellations en Mésopotamie correspondait à des mystères magico-religieux que l’on doit distinguer de ceux de la dévotion publique et de la religion officielle. « Ils appartenaient, dit É. Dhorme, à la religion des initiés, des astrologues, des devins, qui suivaient sur la sphère céleste les évolutions des êtres mystérieux dont ils faisaient dépendre la vie du monde. Tout devenait dieu dans ce domaine où brillaient les étoiles qu’on avait précisément adoptées, dans l’écriture, pour représenter la divinité. » Cette adoration des astres a été répandue dans tout le monde antique ; on la désigne parfois sous le nom de « sabéisme ». Maïmonide assure que le caractère dominant de ces croyances et de ces pratiques était de favoriser et de protéger par des prières et par des rites les travaux de l’agriculture. Mentionné dans le Coran, le sabéisme y désigne la religion des chrétiens de saint Jean ou « mendaïtes »
Les sociétés secrètes modernes : 4 Les méthodes initiatiques et l'évolution des sciences

En réalité, le sacré ne repose ni sur l’intelligible, ni sur le sensible, ni sur la science, ni sur la métaphysique. Le monde du sacré est fondé éternellement sur l’incarnation du mystère, c’est-à-dire sur l’ordre de l’inconnu et de l’inconnaissable, sur l’ordre du non-humain et non pas sur la seule raison humaine. Et s’il n’y avait pas de transcendance à la base même des mystères, alors il n’y aurait pas non plus de mystères et toutes les sociétés secrètes traditionnelles ne seraient que des écoles de philosophie et des systèmes de morale qui passeraient comme tous les systèmes et comme toutes les écoles. Mais si elles sont fondées sur la transcendance, alors les mystères initiatiques sont réels et non seulement réels mais éternels comme leur principe universel. D’autre part, la voie traditionnelle vers le divin se propose de changer l’homme tout entier et non pas de développer des pouvoirs humains particuliers. Le processus de cette lente métamorphose, c’est l’initiation, et ses méthodes ne présentent aucun rapport avec celles de l’enseignement et de la pratique des sciences…
René Alleau : Les sociétés secrètes modernes : 3 La géométrie symbolique

Qu’entendons-nous par l’expression : « géométrie symbolique » ? Nous avons naguère essayé de distinguer aussi précisément que possible les « synthèmes » et les symboles à partir de la différence qui sépare des signes de liens mutuels, de nature sociale et profane, des signes d’une ou de plusieurs liaisons, de nature religieuse et sacrée, attestée soit par des initiations, soit par les rites. Les « synthèmes » suggèrent des rapports rationnels descriptibles ; les symboles évoquent, dans leur essence, des relations spirituelles qui ne sont ni mesurables ni exprimables de façon totalement adéquate. De plus, nous avons indiqué qu’entre les synthèmes sociaux et les symboles sacrés se situaient les emblèmes, bases du langage de l’art. Ainsi peut-on concevoir qu’une géométrie puisse être synthématique, emblématique ou symbolique, selon sa structure propre et sa finalité.
Archaka : Du crime au sacrifice

Le péché originel ne précipite donc pas l’humanité sur les chemins du Mal, mais lui ouvre au contraire les voies du Bien. Ou du moins, si le Mal est désormais le compagnon de l’homme, le Bien est tout autant à ses côtés pour le soutenir. Tout ce que l’animal a de monstrueux sans le savoir, l’homme l’a consciemment ; tout ce que l’animal possède de noble, cela aussi l’homme en est présent conscient en lui-même. Capable de tuer, de ruser, d’usurper comme l’animal, il est également, comme l’animal, capable d’aimer, de nourrir, de protéger, mais consciemment, volontairement et, pour cela même, davantage. Entre l’animal et l’homme, la différence ne réside pas dans l’acte ; elle n’est que dans la perception de soi au moment où l’acte s’accomplit. Et cela, c’est la révolution que, sous les dehors d’une fable ésotérique, Moïse décrit dans la Genèse.
René Alleau : Les sociétés secrètes modernes : 2 Les origines de la franc-maçonnerie

Au lieu d’essayer de découvrir les origines de la maçonnerie dans les faits historiques, dans les dates, dans les documents et dans les chartes qui peuvent trop souvent être falsifiés, nous rechercherons ces sources dans le symbolisme initiatique lui-même, c’est-à-dire dans les formes précises que revêt l’influence mystérieuse transmise par l’initiation. Or ce symbolisme est de nature géométrique. Les principaux instruments sacrés d’une loge sont ceux de l’« art du trait », l’équerre et le compas, sans lesquels aucune figure régulière ne peut être obtenue dans la pratique de la construction architecturale…
René Alleau : Les sociétés secrètes modernes : 1 Les sociétés secrètes chinoises

Au cours de sa longue histoire, la Chine a connu toutes les formes possibles de sociétés secrètes, dont elle a toujours été la terre d’élection. Cet immense pays a compté d’innombrables variétés de groupements clandestins qui liaient entre eux les représentants des activités économiques et sociales les plus diverses, les agriculteurs, les commerçants, les hommes politiques, les militaires, les religieux et même les mendiants et les voleurs…
L’ambigüité humaine entretien avec le professeur Maurice Auroux
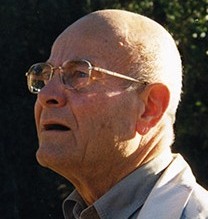
L’animal est agressif pour survivre. Tandis que dans notre agressivité… toutes les structures cérébrales sont représentées. Il n’y a pas une structure cérébrale qui ne soit en relation avec les autres. Alors notre agressivité va passer par notre néocortex et c’est paradoxal puisque notre néocortex est le siège de la raison, de la réflexion, de l’imagination, bref, de ce qui nous caractérise. Notre agressivité n’est pas celle de l’animal vis-à-vis d’une proie qui s’échappe et qu’il poursuit parce qu’il a faim : nous, nous sommes capables d’agresser parce que notre imagination, l’idée que nous avons de nous-même peut nous entraîner, via l’affirmation de soi, à devenir violent.