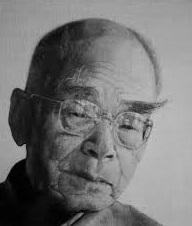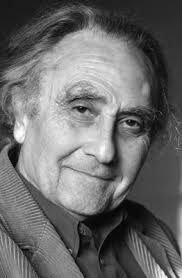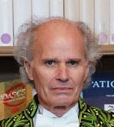Ainsi, d’une part, il se sait et se dit conditionné, d’autre part, il a la certitude que ce conditionnement-là, de ce côté-là de la barricade, entraîne comme conséquence, le privilège d’une lucidité objective ! Cette contradiction est si forte qu’en lisant ceci tu pourrais croire, à un renversement de positions si tu ne savais que cette cristallisation de l’Idée est, depuis que l’homme cherche à prendre contact avec lui-même, la barrière qu’oppose à la vérité la perception de la vérité. En effet, il ne semble pas qu’on ait encore proposé à la pensée de se fondre à la perception sans la représenter. Au lieu d’être le mouvement même de la perception, la pensée s’imagine fonctionner lorsqu’elle manipule des idées à la manière dont un maçon manipule des briques. Mais hélas, aussitôt qu’apparaît l’idée que je m’en fais, la perception s’arrête en admettant même qu’elle ait été authentique. Car chaque idée ou chaque représentation vient se greffer à la blessure-qui-s’ignore, à ce moi qui ne peut s’empêcher de faire que cette perception devienne « ma » perception et l’idée que je m’en fais le déguisement de sa Terreur ou de son avidité. Cet envoûtement n’est jamais en défaut, il nous définit et nous n’en sommes que le jeu, un jeu qui ne consiste qu’à tricher.
Joë Bousquet, René Daumal & Carlo Suarès : Dialogues sur la comédie psychologique