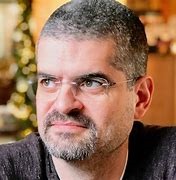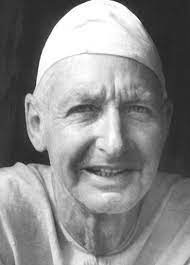Évry Schatzman est directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, membre de l’Académie des Sciences, l’un des maîtres de l’Astrophysique théorique contemporaine. Il est donc bien préparé pour traiter ce problème célèbre. Il vient de le faire dans un petit livre qui fait le point de la question, d’une manière scientifique : […]
Claude Tresmontant : La pluralité des mondes habités