Le caractère fondamental des modèles théoriques que nous offrent les diverses formulations du Non-dualisme oriental consiste dans l’affirmation simultanée et paradoxale de la Transcendance radicale de l’Absolu et de son immanence intégrale au monde ou à la manifestation. Cette transcendance à la fois radicale et intégrative de l’Absolu nous paraît constituer l’expression la plus authentique et la plus achevée de ce que Nietzsche appelait « l’affirmation originaire », se situant au-delà du « nihilisme » et de la fuite vers les « arrière – mondes », mais dont la philosophie même de Nietzsche ne nous offre qu’une expression mutilée.
Étiquette : Non-dualité
W.A. Keers - Ce que nous sommes - entretien à paris en octobre 1984
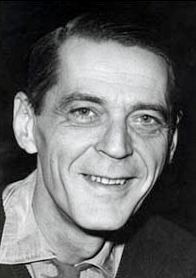
C’est uniquement pour la personne qu’il y a progrès, pas pour votre vraie nature. La réalisation du Soi est immédiate, c’est l’axe. Si vous dites : « ah, ma maison est encore sale, je vais nettoyer le grenier » — tout en faisant le ménage vous serez naturellement maintenant, sans aucune progression. Donc pouvez-vous toujours faire votre toilette, vous modifier puisque vous êtes la deuxième Vénus de Botticelli et parvenir directement au septième ciel, mais ce que vous êtes, enregistrez bien ce mot : ce que vous « Êtes », vous ne pouvez pas l’atteindre puisque vous l’êtes ! Savez-vous qu’il existe un endroit, un drôle d’endroit — vous allez comprendre tout de suite — le seul lieu au monde d’où il soit impossible, par n’importe moyen de transport, d’aller à Paris ?… C’est la réponse ! Oui, la notion de progrès est contaminée par l’idée que le sentir et le penser pourraient comprendre quelque chose. Les pensées ne sont que des objets, comme les papillons, les chaises, comme l’Europe ; elles ne connaissent rien, elles sont connues. Vous êtes cette Connaissance dans laquelle paraissent les concepts et vous projetez celle-ci sur eux. Comment imaginer que ce soit la pensée qui sache quelque chose ? La pensée est objet, pas sujet !
Laisser l’intérieur agir Jean Klein
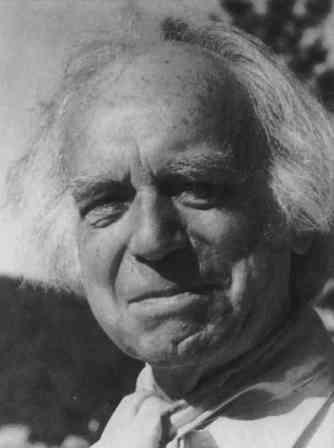
Ce silence intérieur fait accepter, aimer, comprendre ce qui se présente et que nous considérons à ce moment-là comme un cadeau. Toute perception, toute pensée est une énergie en mouvement, retournant automatiquement à son origine. Laissez donc l’objet s’épanouir, il se perdra et révélera votre conscience ultime, accueillez chaque rappel, qu’il soit sous une forme ou sous une autre, sans immixtion d’aucune sorte entre lui et votre présence.
Entretien avec Nisargadatta maharaj 1980

Il n’est besoin ici d’aucun « comment ». Gardez en mémoire le sentiment « je suis », fondez-vous en lui jusqu’à ce que pensée et sentiment deviennent un. En renouvelant les tentatives, tôt ou tard vous obtiendrez le juste équilibre entre attention et affection et votre intellect sera alors fermement ancré dans cette pensée-émotion « je suis ». Quoi que vous puissiez penser, dire ou faire, ce sentiment immuable et chaleureux d’être demeurera en tant qu’arrière-plan permanent de toute activité cérébrale.
Robert Linssen : La physique nouvelle et l'expérience mystique du "corps cosmique"
Lorsque le silence mental est parfait, une véritable mutation psychologique et spirituelle se produit. Elle s’accompagne instantanément d’un déplacement ou d’un transfert du centre de la conscience, généralement éprouvé dans le cerveau avant l’expérience, vers le « plexus solaire » et le « Hara ». Lorsque cette expérience est pleinement vécue, ce transfert du centre de la conscience est définitif. Il n’est pas le résultat d’un acte de volonté de l’ego.
Robert Powell : Notre dilemme
La méditation est donc un processus de « perception pure » sans autre identification à ce qui est perçu, sans aucun désir d’y changer quoi que ce soit. On ne fait que constater l’agitation de l’esprit et refuser d’être entraîné dans le fossé de « l’individualité ». Ce refus n’est pas un acte de volonté, mais une manifestation spontanée, dans un état d’attention dépouillée et totale, où l’esprit résiste aux nombreux pièges qui pourraient le leurrer.
Robert Powell : Libération et dualité
Deux formes prédominantes caractérisent la recherche de libération de l’humanité à travers les âges. De larges secteurs de l’Est se sont préoccupés spécifiquement de la libération intime, n’accordant qu’une importance secondaire au monde extérieur et matériel. Cette attitude a évidemment conduit à une forme de quiétisme quant aux activités profanes et s’est traduite par une négligence des conditions de vie matérielles.
Muriel Daw : Par delà les opposés bien-mal / noir-blanc/ naissance-mort / jour-nuit/ jeune-vieux
Plus on s’éloigne des extrêmes, plus on est libre. Il est merveilleux de ne pas être, par contrainte, séduit par un raisonnement, de ne pas sentir qu’on doit prendre parti. C’est seulement l’égo avide qui a besoin d’avoir une opinion et d’arriver à une conclusion. Seul l’égo personnel a besoin de se « reposer sur un principe ».
Sankara Menon : Données essentielles de la culture hindoue
Pour la plupart des Indiens, le concept de base qui a dominé la pensée et la vie hindoues est l’affirmation de l’unité de la vie ; je ne suis pas sans savoir que des systèmes dualistes ou pluralistes ont été connus dans l’Inde et y ont acquis un grand prestige. Mais tandis qu’on les respectait, leurs conclusions sur la Réalité Ultime n’ont pas été admises en définitive. La déclaration fameuse du Rig-Veda sur « L’Un auquel les Sages donnent bien des noms », montre que cette conviction se rencontre chez les Hindous dès l’aube de l’histoire.
Emile Gillabert : Vie naturelle et réalisation intemporelle

Ce qu’il faut souligner, c’est l’importance de l’état intérieur de celui qui recherche sa réalisation. La liberté et l’harmonie ne peuvent s’instaurer que chez l’homme qui a surmonté le dualisme: ce qui suppose que sa vision compensatrice du monde a pu se faire d’une façon aisée et naturelle favorisant une acceptation sans laquelle la vie conduirait au désespoir. L’homme qui reste dans l’optique dualiste tend à accorder au principe positif une valeur exclusive par rapport au principe négatif et à l’identifier à Dieu, tandis que le second devient le Diable. Cette opposition est contraire à l’idée de l’Etre suprême qui englobe les inverses complémentaires.