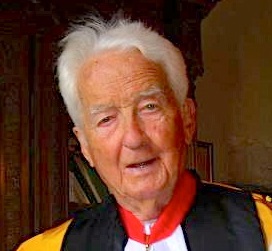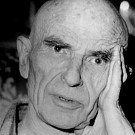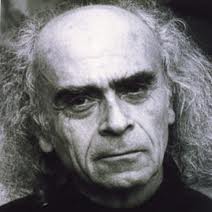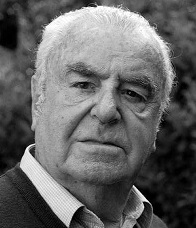Traduction libre Le négationnisme de Steven Pinker révèle les préjugés de l’establishment scientifique Steven Pinker aime à se présenter comme un exemple de la science luttant contre une marée ascendante de déraison. Mais lorsqu’il s’agit de phénomènes qui vont à l’encontre de ses propres croyances, il est lui-même remarquablement irrationnel : il affirme que les […]
Rupert Sheldrake : Les rationalistes se trompent sur la télépathie